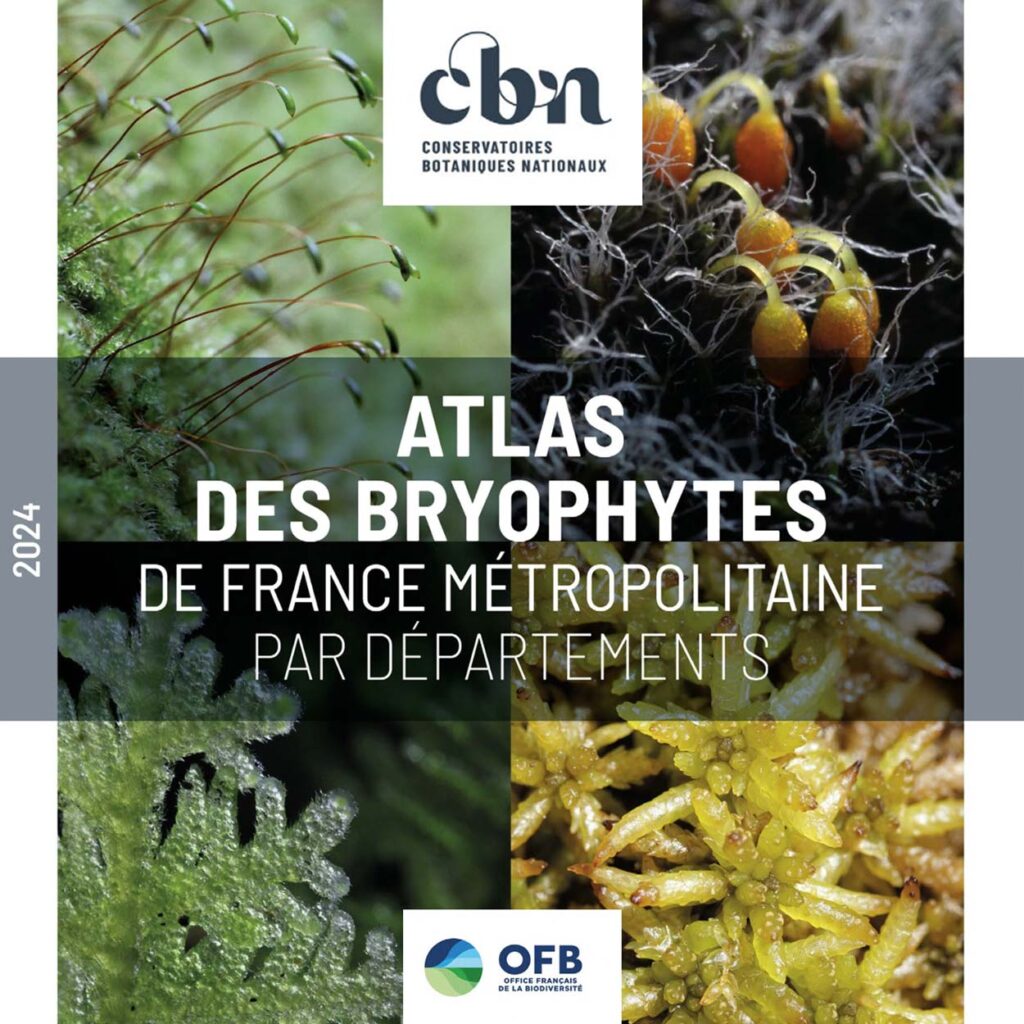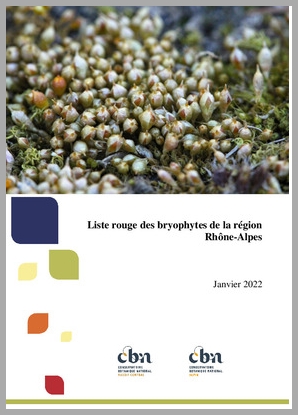La bryologie étudie trois embranchements de plantes terrestres qui ne possèdent pas de vrai système vasculaire : les mousses, les hépatiques et les anthocérotes. Des plantes peu connues aux noms barbares mais dont le rôle sur les écosystèmes est fondamental.
Une discipline à part entière

Le Conservatoire étudie la bryoflore depuis 2008. Ce travail nécessite des approches et des méthodes différentes de celles utilisées pour la flore vasculaire. Les prospections tiennent compte d’une plus grande diversité de micro-habitats, le temps de détermination des récoltes est nettement supérieur (nécessité de préparation et d’observations microscopiques).
Actuellement, la base de données du Conservatoire recense près de 250 000 observations de bryophytes et 1 081 espèces, soit plus des trois-quarts des 1330 espèces connues en France métropolitaine ! Parmi elles, des dizaines n’existent en France que dans les Alpes.
Plusieurs axes de travail ont été suivis :
- Le dépouillement des données bibliographiques existantes ;
- Des inventaires de sites sur lesquels les bryologues recensent le maximum d’espèces présentes sur un périmètre donné (Réserve naturelle, ZNIEFF, ENS…) et identifient les éventuels enjeux de conservation en lien avec la présence d’espèces rares ou menacées ;
- Des suivis « habitats centrés » où les bryophytes sont utilisées comme bio-indicateurs afin de caractériser l’état de conservation des habitats et mieux comprendre leur fonctionnement (tourbières, sources pétrifiantes, milieux forestiers, éboulis froids) ;
- Des prospections ciblées sur la recherche d’espèces patrimoniales ou d’espèces rares non revues depuis plusieurs dizaines d’années ;
- L’animation d’un réseau de correspondants ;
- La proposition de formations à la reconnaissance des espèces protégées.
L’ambition actuelle est de déployer l’inventaire des bryophytes selon un échantillonnage à la maille pour homogénéiser le niveau de connaissance sur tout le territoire.
Des enjeux qui explosent





Les bryophytes jouent un rôle prépondérant dans la structuration, le fonctionnement écologique et la dynamique de nombreux habitats :
- tourbières hautes ;
- marais de transition ;
- sources pétrifiantes ;
- et, d’une manière générale, dans les zones humides, les milieux rocheux et forestiers.
Ces organismes hyperspécialisés apportent de précieuses informations en termes de fonctionnement, de naturalité et d’état de conservation des milieux. Leur étude est donc très utile pour les travaux d’expertise, de caractérisation, de suivi et de cartographie des habitats.
En Europe, 19 espèces de bryophytes sont définies d’intérêt communautaire. Pour d’autres, dont l’intégralité des sphaignes, les États européens doivent s’assurer que les prélèvements effectués ne nuisent pas à un niveau satisfaisant de conservation.
Par ailleurs, les bryophytes ont été clairement identifiées dans la nouvelle stratégie internationale de conservation de la biodiversité comme le second axe prioritaire sur la connaissance de la flore.
Depuis mai 2013, 14 espèces sont protégées au niveau national et depuis 2022, la région Rhône-Alpes s’est dotée d’une Liste Rouge régionale des bryophytes.
La demande croissante d’expertise émane à la fois des instances nationales (évaluation N2000, check-lists…), des gestionnaires d’espaces naturels, et d’une manière générale des acteurs de la conservation de la biodiversité.